 |
 |
|||

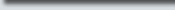
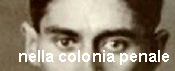
Kafka 1909 – 1924: de Brescia à Kierling
par Nicolas Cazelles
Montichiari, près de Brescia, Italie du Nord, samedi 11 septembre 1909. La quatrième journée du grand meeting aérien de Brescia débute sous un soleil radieux. La foule, aussi compacte que les jours précédents, se presse de bonne heure dans l’espoir de voir évoluer dans les airs les héros du jour : les Italiens Anzani, Cagno, Calderara ; l’Américain Curtiss ; les Français Rougier, Leblanc, et surtout Blériot, tout auréolé de gloire depuis sa récente traversée de la Manche le 25 juillet ; d’autres encore… Dans cette foule, trois visiteurs, trois citoyens autrichiens originaires de Prague : Franz Kafka, 26 ans, son meilleur ami Max Brod, 25 ans, et Otto Brod, le frère de ce dernier. Ils se sont déplacés tout exprès de Riva, au bord du lac de Garde. Max Brod, dans l’ouvrage qu’il consacre à Kafka en 1937, raconte : «En plein milieu de cette vie idyllique, le journal (…) nous apporta la surprenante nouvelle que le premier meeting aérien italien allait avoir lieu à Brescia. Nous n’avions encore jamais vu d’aéroplane, et c’est dans le plus grand enthousiasme que nous décidâmes de nous rendre à Brescia malgré l’état précaire de notre caisse (…) Kafka surtout poussait à cette excursion… »
«Kafka surtout poussait à cette excursion… » : voilà sans doute ce qu’il importait à Brod de souligner en évoquant ce souvenir. Car il développe : Kafka, assure-t-il, était tout sauf un ascète, « il s’intéressait à toutes les actualités, aux nouveautés d’ordre technique, aux débuts du cinéma par exemple (…), il suivait l’évolution moderne avec une inlassable curiosité… »
Cette défense appuyée de Kafka a de quoi surprendre : l’écrivain, en 1909, n’avait-il donc rien encore de l’ascète qu’il devint assurément pour une bonne part plus tard ? Etait-il véritablement un curieux, un optimiste, un moderniste, comme le suggère son ami ?
Un document précieux, bien que peu connu, peut nous aider à répondre à cette question : il s’agit d’un article rédigé par Kafka dès son retour, et publié presque aussitôt, le 19 septembre, dans Bohemia, le quotidien allemand de Prague. Ce texte d’environ quinze pages standard s’intitule « Les aéroplanes à Brescia » ( « Die Aeroplane in Brescia »)
Voici son histoire.
Kafka, selon Brod, traversait à cette époque une de ces périodes « de léthargie et de désespoir » qui lui étaient coutumières, et son ami voulut « lui prouver que ses craintes au sujet de son aridité littéraire n’étaient pas fondées. » Constatant l’enthousiasme que soulevait en lui ce meeting aérien, il lui propose alors « une compétition » : « Je demandai à Franz d’écrire tout ce qu’il aurait observé et d’en faire un article (…) Moi aussi, j’écrirais un article, et (…) on ne verrait qu’à la fin qui avait mis dans le mille. » Ainsi, Brod ne proposait rien moins à son ami que de le défier dans son aptitude à restituer le réel.
Kafka s’exécute, livrant du même coup à la postérité l’unique reportage qu’il eût jamais écrit : l’auteur à venir du Verdict, de La Métamorphose, du Procès, du Château, de tant d’œuvres si peu réalistes, accepte de jouer le jeu de la vérité ! Mieux encore, on l’a vu, de laisser publier le fruit de son travail !
« Nous sommes arrivés. Devant l’aérodrome s’étend encore une vaste place avec de petites cabanes en bois suspectes… »
Ainsi débute l’article que les lecteurs de Bohemia découvrent en première page de leur quotidien. Mais voici comment débutait celui que Brod avait transmis pour publication à l’écrivain Paul Wiegler, responsable des pages artistiques et littéraires :
« La Sentinella Bresciana du 9 septembre 1909 annonce avec enthousiasme : ‘Nous avons en ce moment à Brescia une foule comme on n’en avait jamais vu, même pas au moment des grandes courses d’automobiles (…)’
La lecture de ces informations nous inspire, à mes deux amis et à moi-même, à la fois du courage et de la peur. Du courage : car, lorsqu’il y a une affluence aussi terrifiante, tout se passe d’ordinaire de façon fort démocratique, et là où il n’y a pas de places, on est dispensé d’avoir à en chercher une. De la peur : peur de l’organisation italienne pour une entreprise telle que celle-là, peur des comités qui prendront soin de nous, peur des chemins de fer, auxquels la Sentinella Bresciana attribue glorieusement des retards de quatre heures… »
Kafka, en effet, avait dû se soumettre aux impératifs de la presse écrite, et il avait accepté, apparemment de bon cœur, de supprimer le long préambule par lequel il relatait les faits et gestes des trois amis, depuis la découverte de l’article de la Sentinella Bresciana jusqu’au moment où ils pénétraient dans le circuito de Montichiari.
Mais, des deux versions de l’article, c’est tout naturellement la version d’origine, la plus longue, la plus authentique, qui fut universellement retenue et publiée dans les œuvres complètes de Kafka. Or, n’est-il pas frappant, même si l’on fait la part de l’humour, de constater dans l’ouverture de celle-ci la présence massive, quasi obsédante, et ce dès le premier paragraphe, de cette « peur » (« Angst ») que le lecteur de Kafka retrouve d’un bout à l’autre de ses écrits ? Rien de tel chez Brod, dont l’article, Semaine d’aviation à Brescia ( Flugwoche in Brescia ), parut à son tour à l’automne 1909 dans la revue März 3. Quand bien même il le commence en utilisant lui aussi le « nous » pour désigner les trois amis, il serre de près le thème proposé ( le meeting aérien ), et fait preuve d’entrée de jeu d’un enthousiasme dénué de toute ambiguïté :
« Comme s’il n’y avait plus rien d’autre dans le vaste monde, toute la journée nous sommes assis, nous sommes debout, du matin jusqu’au soir, sur l’immense circuit de Brescia. Avons-nous encore une autre patrie que ce bois étiré en clôture, empilé en tribunes, qui brille comme du métal au soleil et brûle sous ses rayons, aussi loin que porte le regard ? Et nous nous sommes si profondément incrustés dans ce champ et sa pelouse gris-vert trouée çà et là de terre brune, dans cette forêt lointaine d’un bleu laiteux qui paraît toute menue à l’horizon tout en le barrant définitivement, dans ce tumulte d’une humanité étrangère, que nous nous disons : après cette réalité que nous sommes en train de voir, tout ce que nous serons amenés à voir plus tard nous fera l’effet d’un rêve… C’est vraiment quelque chose !... »
En fait, la comparaison systématique de l’intégralité des deux « reportages » est singulièrement parlante. Elle va nous permettre, jusqu’à un certain point, de désigner le vainqueur de la « compétition » imaginée par Brod, et surtout d’esquisser le portrait de Kafka en jeune écrivain. Mais encore faut-il, au préalable, prendre connaissance de la réalité que les deux reporters amateurs s’étaient donné pour tâche de croquer.
Le meeting aérien de Brescia débuta le 8 septembre pour s’achever le 21. C’était le deuxième du genre après la grande semaine d’aviation de Reims, qui s’était déroulée en août sur le circuit de Bétheny, et avait remporté un franc succès. Autant dire que le public était loin d’être blasé, et qu’une telle manifestation ne pouvait manquer de connaître un retentissement considérable. C’est ce qui se produisit : tout au long de ces deux semaines, une foule impressionnante envahit le champ d’aviation de Montichiari, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Brescia. Une foule d’Italiens, bien sûr, mais aussi d’étrangers venus des quatre coins de l’Europe et même d’Amérique. Bref, au-delà de la dimension technologique et sportive de l’événement, il s’agissait également d’un formidable rassemblement populaire et mondain. Et ce sont tout naturellement ces deux aspects de l’événement qui retinrent en priorité l’attention de Kafka et Brod.
Les trois amis, on le sait avec certitude, ne consacrèrent qu’une journée au meeting aérien : après avoir passé la nuit du 10 au 11 à Brescia dans une auberge minable dont Kafka se délecte à décrire la crasse, ils empruntèrent au matin un train à vapeur « lamentable », selon Kafka, qui les achemina en une petite heure jusqu’à Montichiari. La journée du 11 s’y déroula pour l’essentiel comme suit. Le matin, entre 10 h. et 14 h., aucun vol digne de ce nom, les spectateurs restent sur leur faim. A 14 h., début de la compétition officielle en la présence d’un grand concours de célébrités : le prince Borghese, Puccini, D’Annunzio… Tentatives infructueuses jusqu’à 15 h., puis Rougier et Blériot effectuent en alternance quatre vols peu significatifs. A 17 h. et quelques, Blériot entreprend un nouvel essai qui lui vaut cette fois les applaudissements du public : il a bouclé deux tours de circuit. Juste après lui, c’est maintenant Curtiss qui décolle, et qui va offrir aux 50 000 visiteurs enthousiastes un splendide spectacle : « il raid dell’Americano », selon la formule de la Sentinella Bresciana du 12, amène l’aviateur, à l’issue de cinq tours de circuit, à couvrir une distance de 50 km. en 49 minutes. Cette performance lui vaut de remporter le Grand Prix International de Brescia. Enfin, entre 18 h. 30 et la clôture du spectacle, à 19 h., le public a droit à une vison saisissante, à en croire le correspondant français du Temps du 12 septembre :
« Alors que le Grand Prix de Brescia de 50km. venait d’être remporté par le flegmatique américain, paraissait Rougier, plus élevé au-dessus de l’horizon. En trois orbes immenses il gagna l’atmosphère, diminué de tour en tour, mais profilé nettement sur un ciel multicolore.
Le public nombreux qui avait accueilli Curtiss par des vivats, des acclamations, des vociférations, était maintenant silencieux. Rougier montait toujours. Une première fois à 90 mètres, puis dans un dernier passage, face aux tribunes, il atteignit 116 mètres. Alors il redescendit lentement vers le sol. La foule précipitée vers la piste d’atterrissage, déchaînée, heureuse, difficilement contenue, s’empara de Rougier. Vingt bras le saisirent, il fut porté en triomphe, étourdi, renversé, quand il revint au sol ; des femmes se jetaient sur lui, l’embrassaient, lui serraient les mains… »
On le voit : après une matinée pauvre en émotions, cette journée du 11 septembre fut, dans son ensemble, à la hauteur des attentes des trois lecteurs de la gazette bresciane. Mais, pour en revenir au « jeu » de Brod, qui des deux écrivains avait le mieux « mis dans le mille » ? Il faut lire la grande presse de l’époque et ses comptes rendus des premiers grands meetings aériens pour comprendre que ceux-ci constituaient des événements collectifs d’une intense charge émotive. Des hommes osaient défier devant leurs semblables des lois qu’il semblait impossible il y a peu encore de bafouer impunément : frêles silhouettes dans des machines volantes non moins frêles faites de bois et de tissu, on les voyait, au péril de leur vie, se fondre dans les lointains ou bien encore monter toujours plus haut, comme s’il ne leur était plus interdit de disputer aux dieux les hauteurs invisibles des cieux. Spectacle inouï, superbe, grandiose, offert à des foules partagées entre l’exultation et la crainte. Assomption de nouveaux héros en lesquels l’humanité pouvait se voir soulevée au-dessus de sa condition terrestre. Perspectives fascinantes également pour tous ceux, plus lucides ou plus posés, qui entrevoyaient déjà les bouleversements que la conquête du ciel allait entraîner en temps de paix comme en temps de guerre. Un meeting aérien, en cette époque pionnière, c’était tout cela en même temps, à voir et à vivre en une communion de milliers d’hommes et de femmes de tous âges et de toutes conditions rassemblés pour quelques jours ou quelques heures autour de leurs nouveaux dieux. Mais laissons la parole à D’Annunzio, lui aussi présent en ce 11 septembre à Montichiari, et témoin exceptionnel, par son emphase même, de cette commune célébration. Voici comment il transpose le champ d’aviation de Montichiari dans son fameux roman Forse che si, forse che no paru un an plus tard, en 1910 :
« Le ciel recourbé sur la plaine fut un immense stade bleu enclos de nuages, de montagnes, de forêts. La foule accourut au spectacle comme à une assomption de l’espèce. Le péril sembla l’axe de la vie sublime. Tous les fronts durent se lever (…)
Au sommet des mâts, au sommet des hautes bornes pyramidales, au sommet des tours de vedette, les bannières et les flammes multicolores claquaient comme dans les pavoisements de fêtes. Et, comme les anciens pavois des infanteries communales, les façades des clôtures étaient peintes joyeusement aux couleurs des nations, aux emblèmes des chantiers, au nom des timoniers célestes. »
Et voici comment il transfigure notre concitoyen Blériot, voyant en lui
« …le héros seul, avec son camail de drap brun, avec sa cotte bleue d’ouvrier sur la ceinture de sauvetage, avec son profil aquilin de Franc qui a abaissé la framée, abrité sa bouche sous la moustache comme sous une barrière. »
« Mettre dans le mille », était-ce écrire ainsi, pour Brod ? A en juger par l’irrévérence du portrait qu’il brosse de D’Annunzio dans son propre reportage, on peut en douter :
« Je le regarde avec curiosité, et non sans émotion. Il porte des chaussures jaunes à bouts blancs vernis. Mais, sans doute parce qu’il a l’air si soigné et une cravate si majestueuse, je remarque une petite tache de boue en forme de cercle sur la jambe gauche de son pantalon et un fil bleu sur son épaule droite. »
Et tout son article le confirme : même s’il convient de faire la part de la différence des genres (reportage / fiction), Brod, en abordant le même thème, se situe aux antipodes de la grandiloquence de D’Annunzio. Il manie volontiers l’ironie lorsqu’il décrit toutes les tentatives manquées des pilotes. Il raille les prétentions chauvines des Italiens quand leurs aviateurs cassent leurs machines les unes après les autres. Il ose comparer les aéroplanes à de vulgaires batteuses. Il s’attarde à décrire avec impertinence les monotones extravagances de la mode féminine. Il pétille, il brille. Il sait prendre du recul par rapport à l’événement, et mettre en lumière des travers qui amusent. Mais enfin, cette ultime vision qu’il propose à ses lecteurs s’accorde pleinement avec le début de son article :
« Je ne vois plus que cet homme qui passe en claudiquant, fatigué, courbé, touchant légèrement sa casquette de la main, sans lever les yeux, Curtiss, qui remercie d’un air indifférent ces milliers de gens, et marche sans un mot, en imaginant déjà peut-être, une fois de plus, de nouveaux progrès. Il dégage en même temps de la douceur et de l’énergie. »
Et l’on distingue ici comme là le même ton, où se mêlent en demi-teinte méditation, poésie, rêverie, mais aussi confiance : « c’est vraiment quelque chose » en effet, semble dire Brod à son lecteur en prenant congé de lui, que de s’abîmer dans la contemplation de ce héros progressant en silence sur la voie qui va s’ouvrir demain devant l’humanité toute entière. Dans sa Semaine d’aviation à Brescia, Brod sut indiscutablement trouver la note juste : sans jamais cacher à ses lecteurs que la beauté du spectacle dépeint n’était pas étrangère au clinquant et aux paillettes, il s’est néanmoins refusé à le priver de sa dimension mythique.
Deux années plus tard, à l’automne 1911, Brod convainc Kafka, non sans peine (1), de le laisser publier son article au côté du sien propre dans un recueil qu’il intitule La beauté des images laides (Die Schönheit hässlicher Bilder) : « (…) ces variations vont ensemble, se complètent, s’éclairent, s’embellissent mutuellement », écrivait-il en préface à leurs deux reportages (2). Il avait raison, mais en quel sens ? On pourrait répondre que la mise en regard de leurs deux reportages fait apparaître avec une singulière netteté deux sensibilités artistiques fort éloignées l’une de l’autre. Et l’on pourrait ajouter, pour affiner ce point de vue : autant l’un, Brod, est en prise directe avec le monde comme il va, autant l’autre, Kafka, paraît avoir du mal à s’y sentir chez lui. En d’autres termes : derrière le « reporter » qui rédigea Les Aéroplanes à Brescia en 1909, c’est déjà, indiscutablement, l’écrivain Kafka, avec ses thèmes et ses motifs, avec son ton, avec son style si particulier, que l’on voit se profiler. Et si cet écrivain-là sait en quelque manière « mettre dans le mille » à son tour, ce n’est plus, comme on va le voir, au sens où on l’entend généralement.
Kafka introduit donc son article original par un long préambule représentant plus d’un cinquième de l’ensemble. Ce préambule offre quatre développements. Un : la lecture des informations sensationnelles concernant le meeting, et les réactions qu’elle provoque chez les trois amis, avec cette « peur » si fortement soulignée. Deux : en un court paragraphe, l’arrivée du trio « dans le trou noir de la gare de Brescia », et le serment que les trois hommes se prêtent « gravement » de ne jamais se séparer : « N’arrivons-nous pas avec une sorte d’esprit d’hostilité ? », explique Kafka. Trois : une description si étrange de l’auberge où ils sont accueillis le 10 au soir, qu’on se doit de la citer presque entièrement :
« L’auberge vers laquelle on nous dirige nous paraît à première vue la plus sale de toutes celles que nous avions vues jusqu’alors, mais nous trouvons bientôt que ce n’est pas si grave. Une saleté bien installée, dont on ne parle plus, une saleté qui ne change plus, qui appartient aux lieux où elle se trouve, qui rend la vie humaine en quelque sorte plus sérieuse et plus terrestre, une saleté d’où notre hôtelier émerge en toute hâte, fier de lui, humble envers nous (…), vraiment, dans de telles conditions, qui aurait encore quelque chose sur le cœur contre cette saleté ? »
Enfin, quatre : en un récit non moins étonnant, leur déplacement de Brescia à Montichiari dans un train plus que bondé, où l’on découvre notamment l’auteur, Kafka, « pressé contre un géant debout, les jambes écartées sur les soufflets entre deux wagons, sous une douche de suie et de poussière… »
La peur, l’hostilité, la crasse, le géant… : ces thèmes, ces motifs, par leur nature comme par la place qu’ils prennent dans l’article de Kafka, ont de quoi alerter le connaisseur, et l’inciter à regarder de plus près ce « reportage ».
« Nous sommes arrivés… » : Kafka aborderait-il enfin le sujet, comme le fait d’emblée Brod, lui qui nous introduit sans détours « sur l’immense circuit de Brescia » ? Pas encore : le voilà qui s’attarde maintenant devant l’aérodrome pour nous parler de « petites cabanes suspectes » et de mendiants obèses tendant des bras qu’il se dit tenté de franchir d’un bond…, puis qui revient subitement en arrière pour faire une nouvelle digression occupant toute une page :
« Un soir, à Brescia, nous voulions nous rendre rapidement dans une rue qui, selon nous, devait être assez éloignée. Un cocher demande trois livres, nous en offrons deux… »
De quoi s’agit-il ? D’une course en fiacre que les trois amis, le soir du 10, n’ont pas payé le prix convenu avec le cocher, et du prétendu « remords » ou « repentir » qu’ils en conçurent. Et Kafka de conclure, avant de nous faire enfin franchir les portes de l’aérodrome :
« Mais le remords ne doit pas nous gâcher notre plaisir sur le champ d’aviation ; nous ne ferions ainsi que récolter de nouveaux remords, et nous courons à l’aérodrome plutôt que nous y allons, dans cette allégresse qui se saisit soudain de chacun de nous à tour de rôle sous ce soleil. »
Que d’obstacles, par conséquent, et que d’ombres, avant que le narrateur-auteur puisse connaître pleinement cette joie des sens et cette jubilation qui semblaient pourtant largement partagées par la foule !
Cette difficulté à pénétrer dans le vif du sujet comme sur le champ d’aviation, c’est un premier indice fort des divergences opposant les sensibilités artistiques de Brod et de Kafka. Le second indice, s’il est plus subtil, n’en est pas moins révélateur. Il est à rechercher dans la structure dramatique du récit des événements rapportés par Kafka. Brod et lui, rappelons-le, n’ont passé qu’un jour à Montichiari. Le premier, qui intitule son article « Semaine d’aviation à Brescia », joue le jeu… du mensonge : lorsqu’il écrit qu’ « ils (arrivent) de bon matin, tous (leurs) pores remplis de la poussière du chemin de fer local, et (reprennent) les choses là où (ils les ont) laissées la veille à cause de la lumière qui déclinait », il fait mine d’avoir suivi la compétition de bout en bout, légitimant ainsi le choix de son titre. Le second, lui, en titrant « Les aéroplanes à Brescia », s’affranchit dès l’abord de l’obligation que s’impose Brod, et, tout en respectant d’ailleurs ainsi la réalité vécue, préfère concentrer le récit des événements sur une journée. Il en résulte un resserrement notable de l’action, et l’émergence d’un thème nettement privilégié : celui de l’essor de l’homme et de son propre dépassement. C’est dans ce cadre qu’il nous faut notamment apprécier ces propos quasi aphoristiques que le triomphe de Curtiss inspire à Kafka, et que l’on comparera aux témoignages de Brod et du reporter du Temps :
« Il effectue ainsi cinq tours, vole 50 kilomètres en 49’ 24’’ et gagne ainsi le grand prix de Brescia (…) C’est une performance parfaite. Mais comment apprécier des performances parfaites ? Chacun s’estime à la fin capable de performances parfaites ; il semble que pour des performances parfaites le courage ne soit pas nécessaire. Et tandis que Curtiss travaille là-haut au-dessus des forêts, tandis que sa femme (…) se fait du souci pour lui, la foule l’a presque oublié. » ( C’est nous qui soulignons )
Unité de temps, unité d’action, mais aussi unité de lieu. On est en effet frappé, en lisant Kafka, par l’ensemble des moyens qu’il met en œuvre, plus ou moins consciemment sans doute, pour inscrire l’action considérée comme essentielle, à savoir la compétition sportive et ses différentes phases, dans un lieu clos et bien particulier. C’est d’abord, nous l’avons vu, le temps qu’il met pour pénétrer dans le vif du sujet, et la série d’obstacles qu’il dresse entre Riva, point de départ des trois voyageurs, et l’aérodrome : obstacles physiques et matériels, comme la distance à parcourir, le nombre de transports en commun à utiliser, la foule à Brescia, la crasse des hôtels, la cohue dans le train, les mendiants et leurs bras tentaculaires, la foule encore à l’entrée du terrain d’aviation, etc. ; obstacles psychologiques, comme cette « peur » présentée plus haut, ou bien encore cette crainte de l’aliénation, de la perte de soi, qui transparaît dans ces lignes, juste avant la fin :
« Nous avons la chance de trouver une voiture (…) et, redevenus enfin des existences indépendantes, nous nous mettons en route. »
C’est aussi la vision qu’il nous offre du champ d’aviation lui-même : « il est si grand que tout ce qui s’y trouve semble abandonné… » ; « on a installé ici un désert artificiel », et dans ce « désert ensoleillé », « on ne trouve rien qui distraie le regard » ; « la lumière égale du soleil reste immuable jusque vers cinq heures de l’après-midi », et « il n’y a pas non plus de musique. » Espace public à la fois borné et sans limites, familier et étrange, accueillant et hostile, il évoque pour le connaisseur de Kafka une immense arène où l’homme, à peine visible des spectateurs, se livre à un combat titanesque dont il est en définitive le seul à connaître la tragique beauté.
« Que se passe-t-il ? Là, au-dessus de nous, à vingt mètres au-dessus du sol, un homme est prisonnier dans une cage de bois et lutte contre un danger invisible, certes délibérément affronté. Mais nous, en bas, nous sommes là, inexistants, et nous regardons cet homme-là. »
Tel lui apparaît Blériot dans son envol au-dessus de notre humaine condition ; mais nous avons déjà rencontré Curtiss et sa « performance parfaite », et Kafka nous propose encore cette dernière image du héros avant de prendre congé :
« La route tourne et Rougier paraît si haut qu’on a l’impression de ne plus pouvoir déterminer sa position que par rapport aux étoiles, lesquelles ne vont pas tarder à se montrer dans le ciel, qui s’assombrit déjà. Nous ne cessons pas de nous retourner ; Rougier monte toujours, mais nous nous enfonçons maintenant définitivement dans la Campagna. »
Comment , alors, Kafka sut-il « mettre dans le mille » ? En quel sens peut-on soutenir avec Brod que leurs textes « se complètent, s’éclairent, s’embellissent mutuellement » ? Proposons une réponse commune à ces deux questions : si Kafka sut sans doute mieux que Brod mettre en lumière la dimension mythique de l’événement, la grandeur de l’homme s’arrachant à la terre dans son aéroplane, c’est parce que ce thème trouvait de profondes résonances dans sa propre psyché ; mais c’est cet état de choses lui-même qui l’entraîna, comme par une effet de retour, à noyer cette thématique universelle sous le flot de ses préoccupations intimes. En un mot, si vérité il y a dans son texte, il s’agit bien plus de la vérité intérieure de l’homme et de l’écrivain Franz Kafka, que d’une quelconque vérité particulière (le meeting aérien de Brescia) ou générale (la conquête du ciel).
Kafka a cette phrase étrange pour décrire le Français Rougier qui monte dans les airs, et dont on ne pourra plus bientôt « déterminer (la) position que par rapport aux étoiles » :
« Rougier est assis à ses leviers, comme un monsieur à sa table de travail, à laquelle on peut accéder derrière son dos par une petite échelle. »
« Comme un monsieur à sa table de travail ». L’image est en elle-même si singulière, si inattendue, qu’on ne peut résister au besoin de la rapprocher de celle de Blériot « prisonnier dans une cage de bois », et de se dire, au vu de toutes les étrangetés déjà signalées, que Kafka projeta sur la personne des héros-pilotes sa propre problématique. Et c’est du coup l’ensemble de son texte qui va se charger d’une signification nouvelle, et nous aider grandement en effet à esquisser le portrait de Franz Kafka en jeune écrivain.
L’homme, ici, tel qu’il se peint lui-même auprès de ses deux compagnons de voyage, est déjà celui que le Journal et la Correspondance nous feront découvrir : craintif, et même, beaucoup plus fondamentalement, pétri d’angoisse (Angst) ; casanier en dépit de ses velléités de rupture ; obsédé par l’hygiène, et conséquemment par la saleté ; à la fois fasciné et troublé par les femmes ; assoiffé d’amitié et solitaire ; jouisseur et ascète ; idéaliste et sceptique… Quant à l’artiste, en l’occurrence à l’écrivain et à l’idée que se fait Kafka de sa mission, de sa condition, des espérances qu’il peut légitimement placer dans ses œuvres, on les voit transparaître avec une étonnante netteté dans les ébauches qu’il nous offre de Blériot, de Curtiss et de Rougier dans l’exercice de leur art. Kafka, décrivant Blériot s’apprêtant à décoller, nous livre la méditation suivante (3) :
« C’est avec cette chose minuscule qu’il veut se lancer dans les airs ? Sur l’eau, par exemple, c’est plus facile. On peut s’exercer d’abord sur des mares, puis sur des étangs, puis sur des fleuves et seulement beaucoup plus tard se lancer sur la mer ; pour celui-là, il n’y a que la mer. »
Pour le pilote, comme pour l’artiste selon Kafka, il n’y a que la mer. Et pourtant, qui sait rendre justice à ces « performances parfaites » qu’il exécute pour son public au mépris de sa vie ?
Telle est l’une des questions essentielles que pose Un artiste de la faim, ce texte de Kafka autrement plus connu que Les aéroplanes à Brescia, cette nouvelle bouleversante dont il relisait les épreuves sur son lit de mort en mai 1924, à Kierling.
Kierling, dans la campagne viennoise, au modeste sanatorium du docteur Hoffmann. Kafka y occupe depuis le 19 avril 1924 une belle chambre individuelle avec balcon donnant sur un bois. Il est entouré jour et nuit des soins de Dora Diamant, sa toute jeune compagne, et de son fidèle ami Robert Klopstock, qui a interrompu ses études de médecine pour venir l’assister dans ses derniers moments. Il est perdu : la tuberculose, après le larynx, a maintenant gagné l’épiglotte. Il ne peut ni boire ni manger normalement, ni parler. Sait-il que sa fin est proche ? On l’ignore, mais il note un jour sur un de ces papiers qu’il tend à Dora ou à Klopstock : « Toujours la peur. » Il passe de longues heures sur son balcon, au soleil printanier. Il écrit des lettres, il feuillette des livres, et… il travaille. Il a enfin reçu, à la mi-mai, les épreuves de son dernier recueil de nouvelles, et il entreprend de les corriger. Klopstock témoigne :
« L’état physique de Kafka à ce moment et l’ensemble de la situation, puisque lui-même mourait littéralement de faim, était vraiment un spectacle horrible. Après avoir fini de corriger les épreuves (4), ce qui avait représenté pour lui non seulement un immense effort psychique, mais devait avoir été pour lui une sorte de rencontre spirituelle bouleversante, les larmes lui coulèrent longtemps sur les joues. C’était la première fois que je le voyais manifester une émotion de ce genre. Il avait toujours eu le pouvoir de se dominer à un degré surhumain. » (5) (C’est nous qui soulignons)
Ce recueil, c’est Un artiste de la faim. Comme l’indique son sous-titre, il contient « quatre histoires » : Première souffrance, Une petite femme, Un artiste de la faim, Joséphine la cantatrice ou le Peuple des souris.
Nous allons nous intéresser ici à celle qui donne son titre à l’ensemble, et tâcher de dire en quoi elle s’apparente à ces Aéroplanes à Brescia que Kafka livrait au public quinze ans plus tôt.
Le récit Un artiste de la faim fut composé au printemps 1922 et publié pour la première fois dès le mois d’octobre de la même année dans la revue Neue Rundschau. Kafka, dans une lettre à Brod de juin 1922, le juge « tolérable », un jugement d’autant plus précieux qu’il avait émis précisément le même sur ses Aéroplanes à Brescia (6), et que ce récit compte parmi les très rares œuvres qu’il souhaita explicitement voir échapper au feu (7). Publiée quelques mois après sa création, admise par son auteur à lui survivre, corrigée sur épreuves à la veille de sa mort dans les conditions que l’on sait, on voit que cette nouvelle, pour peu que l’on veuille saisir de l’intérieur la personnalité de l’écrivain Kafka, peut légitimement être abordée comme une pièce cardinale de l’ensemble de son oeuvre. Et de fait, dès sa première lecture, on voit à quel point il en est bien ainsi.
« Un artiste de la faim » : oui, même s’il est peut-être discutable au plan linguistique, le choix fait par Claude David (8) de traduire ainsi littéralement le titre « Hungerkünstler », paraît tout à fait judicieux, et ceci pour deux raisons. L’une, objective, est que ce mot désigne réellement une catégorie d’individus pratiquant à l’époque une forme d’activité professionnelle, sinon un véritable métier : le « Hungerkünstler » jeûnait publiquement moyennant finances ; il n’y a donc pas de raison pour que ce « métier », pratiqué par certains, ne puisse atteindre comme tout autre la dimension d’un « art ». L’autre, en apparence plus subjective mais fondée sur le texte même de Kafka, est que ce dernier a tout mis en œuvre pour nous donner à voir un artiste à part entière. Le métier du héros, le jeûne, est formellement désigné comme un « art » (« Kunst ») pratiqué par un « artiste » (« Künstler »). L’homme, en sa période faste, a sillonné la moitié de l’Europe avec son impresario, et le spectacle qu’il a offert à son « public » (« Publikum ») présente tous les aspects d’un véritable numéro : seul dans sa cage au sol jonché de paille, exposé vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux regards exigeants de la foule dans un « amphithéâtre » qui baigne « dans un éclairage de nuit tamisé », cet artiste exemplaire n’a jamais cessé de tendre vers l’excellence. C’est d’ailleurs pour cette raison même qu’il était « le plus souvent d’humeur mélancolique » lorsqu’il devait cesser de jeûner à l’issue des quarante jours réglementaires :
« Pourquoi s’arrêter juste maintenant, au bout de quarante jours ? Il aurait encore pu tenir longtemps, il aurait pu tenir un temps illimité ; pourquoi s’arrêter maintenant, en plein milieu du jeûne, avant même qu’il n’ait atteint le meilleur du jeûne ? Pourquoi voulait-on le priver de la gloire de continuer à jeûner et, non seulement de devenir le plus grand champion de jeûne de tous les temps, ce qu’il était probablement déjà, mais encore de se dépasser lui-même pour atteindre des records inimaginables, car il ne sentait jamais aucune limite à sa faculté de jeûner ? »
Ce personnage, à l’instar de Curtiss, est un héros, un champion, un artiste dans son domaine. Et, comme Curtiss, ou plus vraisemblablement comme Kafka décrivant Curtiss en train de « travailler (…) là-haut au-dessus des forêts », il est visiblement sujet à la mélancolie. Se sent-il lui aussi le seul à pouvoir évaluer à sa juste mesure la sévère beauté des « performances parfaites » ? On ne peut en douter lorsqu’on le voit des années plus tard, alors même que sa retraite lui permet enfin de s’adonner librement à son art, rongé d’une incurable tristesse :
« (…) et ainsi, le jeûneur continuait à jeûner comme il avait jadis rêvé de le faire, et il y parvenait sans peine, comme il l’avait prédit autrefois ; mais personne ne comptait plus les jours ; personne, pas même le jeûneur lui-même ne savait où en était sa performance et la tristesse prenait possession de son cœur. Et si, par hasard, un oisif s’arrêtait, se moquait du chiffre périmé et parlait de supercherie, c’était bien le mensonge le plus stupide que puissent imaginer l’indifférence et la méchanceté innée, car ce n’était pas le champion de jeûne qui trompait le monde, c’était le monde qui le trompait en le frustrant de son salaire. »
Seul et incompris, cet artiste de la faim l’était autrefois . Seul, il le demeure quand, loin de « plonger le monde dans un étonnement justifié », il accomplit son plus long jeûne dans l’indifférence générale. Seul, il l’est plus que jamais en mourant, lui qui confie dans un souffle cet incroyable secret à l’inspecteur du cirque où il achève sa vie :
« (…) ‘je n’ai pas pu trouver d’aliment qui me plaise. Si j’en avais trouvé un, crois-moi, je n’aurais pas fait tant de façons et je m’en serais repu comme toi et les autres.’
Ce furent ses derniers mots. »
Curtiss et ses « performances parfaites », Blériot dans sa « cage de bois », Rougier « qui monte toujours » en direction des étoiles, assis à ses leviers comme à son bureau : Kafka portraiturait déjà pour son public, en 1909, des artistes étrangement solitaires dans la pratique de leur art. Avec Un artiste de la faim, qui fut écrit en un temps où il se savait définitivement condamné par la maladie, il va beaucoup plus loin dans cette voie : l’accent n’est plus seulement mis sur la singularité de l’artiste pratiquant son métier, mais, de façon beaucoup plus radicale, sur l’incompatibilité de l’art et de la vie.
Avec Un artiste de la faim, c’est en effet une vie entière que Kafka nous invite désormais à contempler. Mais pas une vie comme les autres, pas l’existence d’un tel, né et mort à tel endroit, en telle année. Son histoire n’est pas une biographie au sens où on l’entend communément : même si elle s’inscrit clairement dans le temps qui passe, son héros n’a d’autre identité que son statut. Il n’est rien d’autre que ce qu’il fait. Il est « der Hungerkünstler », « l’artiste de la faim », le jeûneur professionnel. Il incarne un mode de vie bien étrange, puisque celui-ci se définit par opposition même à celui de tout un chacun : alors que pour l’homme la nourriture est la condition même de la vie, il choisit, lui, de vivre en s’en privant. Là est sa joie, là est son art. Telle est, telle fut sa vie durant, sa joie d’artiste. Mais le dénouement nous l’apprend : il savait depuis longtemps, depuis toujours peut-être, que cette joie était mauvaise en son principe ; que nulle joie vraie ne peut naître d’un manquement, d’une tare, d’une faute ; que nulle gloire ne peut ni ne doit revenir à un être qui a failli à son devoir d’homme. Et il meurt dans une indifférence qu’il appelle lui-même de ses vœux :
« ‘Pardonnez-moi tous !’ dit le jeûneur ; seul l’inspecteur, qui avait mis l’oreille contre la grille, comprit ce qu’il disait. ‘Bien sûr !’ dit l’inspecteur en portant le doigt à son front pour indiquer au personnel l’état dans lequel se trouvait le jeûneur, ‘bien sûr, nous te pardonnons.’ ‘J’ai toujours voulu que vous admiriez mon jeûne’, dit le jeûneur. ‘Mais nous l’admirons !’ dit l’inspecteur, conciliant. ‘Mais il ne faut pas l’admirer !’, dit le jeûneur. ‘Bon, dans ce cas-là, nous ne l’admirons pas’, dit l’inspecteur. »
Comment ce récit n’eût-il pas ébranlé Kafka jusqu’au tréfonds en ce mois de mai 1924 ? Comment douter que sa lecture fut pour lui « une sorte de rencontre spirituelle » bouleversante ? Oui, le témoignage de Klopstock emporte assurément l’adhésion. A une condition toutefois : à condition de ne pas relier l’émotion de Kafka, comme son jeune ami semble le faire, aux souffrances réelles et physiques d’un malade incapable de s’alimenter. En relisant les épreuves d’Un artiste de la faim, de la nouvelle seule comme du recueil, c’est sans aucun doute la dimension profondément personnelle et intime de ses quatre histoires qui provoqua chez lui ce choc émotionnel : avec Un artiste de la faim, Première souffrance, Joséphine la cantatrice, et même, dans une certaine mesure, Une petite femme, c’était, quatre fois répétée, toute la vie manquée de Kafka qui défilait devant lui dans une lumière aveuglante.
°
°°°°°
NOTES
(1) « Il veut prendre également mon Brescia pour son livre. Tout ce qu’il y a de bon en moi s’y oppose. » (Journal, 11 novembre 1911)
(2) Ces deux textes durent en fin de compte être supprimés de l’ouvrage et ne parurent jamais ensemble.
(3) Ce passage fut supprimé de la version publiée par Bohemia.
(4) En réalité, il semble que Kafka ne soit pas parvenu jusqu’au bout de sa tâche.
(5) Robert Klopstock, cité par Max Brod, Correspondance, 1902-1924.
(6) « Une bagatelle tolérable », lettre à Felice Bauer du 20 avril 1914.
(7) « De tout ce que j’ai écrit, seuls les livres : Verdict, Soutier, Métamorphose , Colonie pénitentiaire, Médecin de campagne et le récit Un artiste de la faim sont valables. » (Deuxième « testament » de novembre 1922 destiné à Brod).
(8) Claude David a présenté, annoté et pour partie traduit les Œuvres complètes de Kafka dans la Bibliothèque de la Pléiade aux Editions Gallimard. Il a également traduit, préfacé et annoté, chez le même éditeur, tous les textes parus du vivant de Kafka. Il est enfin l’auteur de Franz Kafka, une biographie parue chez Fayard en 1989. Pour ce qui concerne la traduction du terme « Hungerkünstler » dans le corps du texte, on observe que David, contrairement à Kafka qui utilise exclusivement ce terme pour désigner son personnage, choisit la variation : à côté de « artiste de la faim », on trouve aussi « champion de jeûne », « jeûneur » et « jeûneur professionnel ».
2 décembre 2003

